PROTECT YOUR DNA WITH QUANTUM TECHNOLOGY
Orgo-Life the new way to the future Advertising by AdpathwayAlors que le calme est revenu à Mani-utenam après la 41e édition du festival Innu Nikamu – qui signifie « l’Innu chante » – Espaces autochtones est allé à la rencontre de ceux qui ont lancé ce projet sur l’ancien site du pensionnat pour Autochtones de Sept-Îles à Mani-utenam. Retour sur les débuts modestes d’une aventure devenue un événement d’envergure internationale.
On ne veut vraiment pas devenir quelque chose de juste commercial, explique Normand Junior Thirnish, coordonnateur d’Innu Nikamu depuis 2022.

Normand Junior Thirnish est le coordonnateur du Festival Innu Nikamu depuis 2022.
Photo : Radio-Canada / Shushan Bacon
Cet événement musical est un puissant vecteur de guérison pour la réappropriation de la fierté de sa culture et de sa langue, souligne l’ancien policier de la GRC. Guidé par cette vision, le festival a imbriqué dans sa programmation les festivités du pow-wow de Mani-utenam.
Le monde souffre. Il faut faire tout ce qu'on peut pour alléger cette souffrance-là, même si c'est quelques jours : célébrer avec nous, mettre du tabac dans le feu sacré, juste se recueillir quelques secondes ou quelques minutes.
À ses débuts en 1984, le festival n’avait pas cette mission, ni aucune autre vocation particulière d’ailleurs, se remémore Florent Vollant, monument de la musique innue et cofondateur du festival.
Ushkat tshekuan katutemat, atesseun. Apu ut tekuat atesseun. La première chose qu’on a faite, c’est de travailler. Il n’y avait pas de travail à l’époque, raconte-t-il dans sa langue maternelle.

Florent Vollant voulait travaillé, il y a 41 ans et c'est la raison d'être du Festival Innu Nikamu.
Photo : Radio-Canada / Shushan Bacon
Ek nin tan tshe itatusseian. Apu minekuian atesseun. Nika meshken, nika tuten atesseun.Puis, moi, comment je vais [faire pour] travailler? On ne me donne pas de travail. Je vais m’en trouver et me créer mon emploi.
Son travail au départ était de rassembler les musiciens, des amis de Philippe Mckenzie comme Morley Loon, Willy Mitchell et Ernest Monias, le tout sans la technologie d’aujourd’hui pour faciliter la communication entre les artistes.
Ekue mishituepan.Ç’a pris de l’expansion.
Florent Vollant croyait que le festival allait se faire qu’une seule année. Mais contre toutes ses attentes, kie nitautshit. Ça s'est développé.
Maintenant, Innu Nikamu a 41 ans.
Les concepts d’importance de la langue et de chanter dans sa langue se sont ajoutés à la mission du festival au fil du temps.
Au début, aucun des artistes qui jouaient sur la scène d’Innu Nikamu ne chantait dans une langue autochtone. Ils chantaient pratiquement tous en anglais ou en français. Les seuls groupes qui chantaient dans leurs langues maternelles, c’est seulement ceux qui venaient d’ici, comme Kashtin, illustre l’ancien président-directeur général du festival, Sylvain Putu Vollant.

La femme de Sylvain Vollant (à gauche), Danielle Descent (à droite), a travaillé avec Florent Vollant à la première édition du festival.
Photo : Radio-Canada / Shushan Bacon
Les festivaliers sont devenus nombreux, venant des autres communautés autochtones, mais aussi de collectivités allochtones de plus en plus éloignées. Pour Florent Vollant, la raison de cette ampleur est l'importance de se rassembler, surtout que les Innus et les Premières Nations sont nombreux sur le territoire, souligne-t-il.
Il note aussi qu’il n’y avait pas d’Allochtones dans les débuts du festival. Ils n’étaient pas présents à l’époque. Ils avaient peur de nous et ils ont encore peur de nous, mais c’est moins pire.
Aujourd’hui, les Allochtones sont très nombreux, dans la foule comme dans les coulisses, amenant avec eux leurs connaissances. Mais leur présence dans l’organisation de l’événement soulève aussi certaines questions.
Ce savoir est maintenant à Mani-utenam. Nous devons les regarder faire, les observer et nous demander : tshi apishtananu a ne? Voulons-nous l'utiliser [leur savoir-faire]?, mentionne l’auteur-compositeur interprète et fondateur d’Innu Nikamu. Il spécifie que cette manière de faire un festival coûte cher et ça prend de l’argent .
Néanmoins, Florent Vollant précise que le festival, bien qu’énorme, est entre bonnes mains grâce à cette nouvelle génération, celle dont fait partie Normand Junior Thirnish, qui a sa propre vision.
Pas d’accordeur? Pas de problème!
Gilbert Pilot a été le premier animateur du festival Innu Nikamu, rôle qu’il a occupé pendant 25 ans.
Ceux qui ont vu évoluer le festival se souviennent assurément de son cri : iiiiiii-nou-ne-ke-mou. À l’époque, le festival était modeste.
Au début, tarbarnouche, ça faisait : "ding, ding, ding, ding", dit-il en souriant pour imiter une guitare. Il n’y avait pas d’accordeur, là. Les musiciens pendant cinq minutes accordaient leurs instruments pour ensuite chanter. Ils leur restaient seulement 15 minutes au lieu des 20 minutes prévues, relate-t-il en riant.

Gilbert Pilot a animé le festival pendant plusieurs années et il demeure nostalgique de cette époque.
Photo : Radio-Canada / Shushan Bacon
Pour leurs performances, aussi brèves pouvaient-elles être, les artistes recevaient 100 $ quand Innu NIkamu en était à ses balbutiements. Maintenant, ils sont mieux payés et certains dorment dans des roulottes derrière la scène.
Tout en racontant son histoire, Gilbert Pilot avoue qu’il a très mal au dos. Il note aussi qu’il s’ennuie de l’animation, tout en pointant du doigt les deux gigantesques scènes, mais détailler ses souvenirs et ses anecdotes lui fait plaisir.
Aujourd’hui, de voir ce que le festival est devenu alors qu’il était un bébé naissant et maintenant, il est un adulte, ça, j’en suis très fier.
Je me rappelle [des musiciens inuit], les premiers qui jouaient. Ils regardaient plus les autres jouer parce qu’ils essayaient de jouer, puis ils avaient de la misère à s’accorder. Mais après, quand ils sont partis, ils étaient bien contents [d’eux-mêmes] parce qu’ils regardaient les autres jouer, comment ils plaçaient leurs mains, puis ils arrivaient à bien faire, renchérit Sylvain Putu Vollant.
Ce dernier s’est impliqué dès la deuxième édition du festival. Les artistes et les organisateurs ont pu compter sur lui pendant 30 ans. J’aime ça, aider le monde. Mes parents m’ont transmis l’importance d’aider les autres. Donc, les musiciens, ça m’a permis de les aider.
Ses contributions étaient d’abord modestes, notamment en coulisses ou en aidant avec la marchandise promotionnelle, mais il a gravi les échelons pour finalement devenir président-directeur général d’Innu Nikamu.
Plus de quatre décennies plus tard, les artistes autochtones occupent toujours la majorité des cases horaires du festival, mais pas nécessairement le haut de l’affiche, un constat mitigé pour Sylvain Vollant.
Les [gros] noms, oui, mais ce sont des Allochtones et non des Autochtones. On a Ernest Monias, mais la balance, Cœur de Pirate ou d’autres qui viennent, ce sont des Blancs. On peut les voir en spectacle sur son téléphone. Ce n’est pas pareil.
Une croissance qui a un prix
N’empêche, la venue d’artistes non autochtones de renom contribue à attirer des spectateurs et est un signe de croissance, chose qui n’a pas toujours été évidente pour le festival.
Pendant les premières années, il était subventionné par le Canada. Selon Gilbert Pilot, les fonds provenaient de l’Organisation des Nations unies qui étaient dans les balbutiements des travaux pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones, au début des années 80.
Ces fonds permettaient aux festivaliers de profiter des spectacles gratuitement. Après ça, il fallait s’autofinancer. On s’est autofinancé. On a demandé 2 $, mais il n’y avait pas de clôture. Il y avait juste une corde , raconte Sylvain Vollant. Le monde traversait et il revenait payer 2 $, mais c’était leur façon de contribuer au festival. On a augmenté après 10 ou 15 ans à 5 $.
Aujourd’hui, le tarif d’un passeport adulte pour toute la durée du festival s’élève à 160 $, autre signe de l’ampleur qu’a pris Innu Nikamu. Même moi, je n’ai pas les moyens. Je me promène aux alentours, j’écoute la radio. Je vais assister à un ou deux spectacles. Mais pas plus. Puis, je vais surtout aller voir le pow-wow. [...] J’ai mes petits-enfants qui dansent , note l'ancien PDG.
Ce dernier trouve que c’est vraiment gros pour la communauté. Au début, c’était pour rassembler les communautés innues. On sait qu’on est nombreux. Ceux de la Basse-Côte-Nord venaient. Présentement, il faut qu’ils paient 160 $, plus leur hébergement, plus leur bouffe, plus leur transport. Ça fait cher en tabarnouche pour une personne .
Malgré tout, le public demeure au rendez-vous : quelque 15 000 personnes étaient de la partie cette année. Ce bilan ne manque pas d’émouvoir Gilbert Pilot.
Je suis allé voir Normand Junior et je lui ai dit : "Je suis très, très fier de toi d’avoir fait le festival [quelque chose de reconnu au] Québec".
Le logo
Benoit Audette, le frère de la sénatrice Michèle Audette, est celui qui a créé le logo du festival. En 1984, il n’était qu’un adolescent avec un emploi étudiant pour le festival. Il aime se rappeler de cette première édition du festival qui donnait l’impression, selon lui, que le village recevait les Rolling Stones.
Il se souvient qu’Innu Nikamu avait déjà son propre logo, mais que son concept lui est venu d’une proposition de Florent Vollant, le coordonnateur de l’époque. "Ben, penses-tu que tu pourrais nous faire un petit décor?" C’était un dessin sur trois feuilles deplywood qui faisaient l’arrière-plan de la scène , relate-t-il en souriant.
En acquiesçant. Florent Vollant lui a soumis son concept : quelque chose avec une explosion, inspiré d'un dessin qu’il avait vu à l’aéroport de Dorval où une valise se transformait en oiseau.
Puis quelques années plus tard, l’organisation a décidé de prendre le dessin de décor de scène comme logo, à l’initiative de Sylvain Vollant. L’artiste se souvient : j’ai signé un petit papier et j’ai eu un beau petit chèque de 500 $, dit-il en riant.
L'œuvre de Benoît Audette est devenue l'image que le festival utilise à ce jour.

Benoît Audette a créé le logo du festival Innu Nikamu.
Photo : Radio-Canada / Shushan Bacon


 2 months ago
53
2 months ago
53



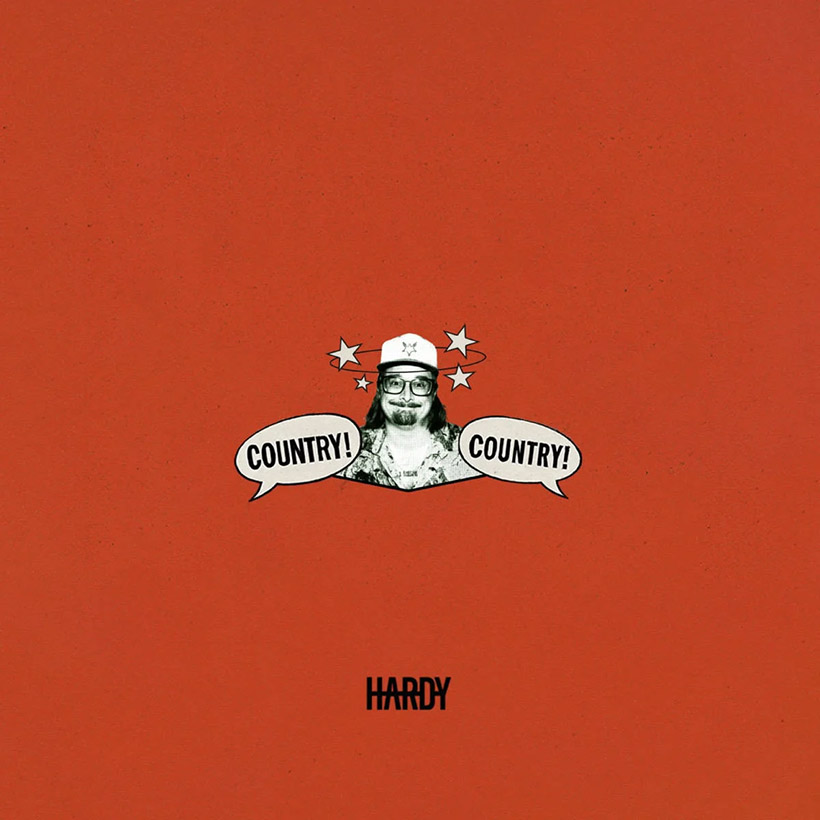













 English (US) ·
English (US) ·  French (CA) ·
French (CA) ·